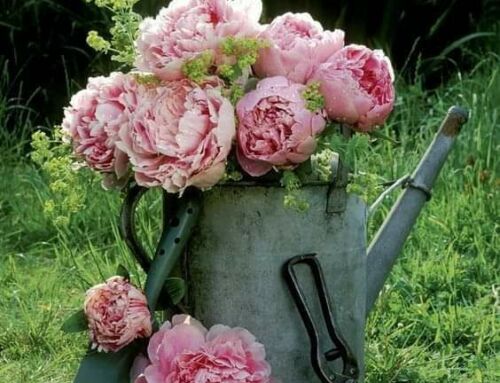Des souvenirs inaccessibles à la conscience
Circuits émotionnels débranchés et mémoire déconnectée
Le traumatisme est l’ensemble des mécanismes de sauvegarde qui peut se mettre en place à la suite d’un ou plusieurs évènements, générant une charge émotionnelle non contrôlée et dépassant les ressources de la personne. Certaines personnes ont une aptitude à la résilience, c’est à dire une capacité de rebondir suite à un évènement traumatisant, pour d’autres, cela révèle de la souffrance et elles développent des symptômes d’un état de stress post traumatique. La personne revit à intervalle plus ou moins longs le moment traumatisant.
Qu’est-ce que le syndrome du stress post-traumatique –SSPT
Appelé également Etat de Stress Post-traumatique (ESPT) ou Trouble de Stress Post-traumatique (TSPT) est classé parmi les troubles anxieux ayant comme origine un évènement traumatisant, une confrontation avec la peur de mourir, que l’on soit victime ou témoin. De là en découle tout un ensemble de mécanismes biologiques, physiologiques et psychologiques.
Stress de l’anglais « contrainte » est un ensemble de réponses de l’organisme qui soumit à des contraintes extérieures s’adapte à la situation inattendue en déclenchant une tempête hormonale. Le corps se prépare à l’agression, à la fuite par l’augmentation de la fréquence cardiaque et une respiration plus rapide; le seuil de vigilance au plus haut, les substances mises à dispositions sont alors utilisées dans l’instinct de survie.
Trauma du grec « blessure avec effraction »
Causes et symptômes
En France, en moyenne 600 milles personnes par an sont touchés par un trouble du stress post-traumatique, mais seulement la moitié d’entre eux sont détectés à temps. Toutefois les spécialistes ont pu établir trois situations qui n’auront pas les mêmes conséquences sur l’individu :
- Catastrophe naturelles, 10 à 20% des victimes seront concernés
- Catastrophe d’origine humaine (ex : accident de la route) 20 à 40%
- Agressions sexuelles graves, attentats, prise d’otages, faits de guerres, 80 à 100%
- Et plus récemment le COVID 19 (pour les patients hospitalisés notamment en réanimation, pour les familles des malades mais aussi pour le personnel soignant)
Un individu qui développe un SSPT présente trois grandes classes de symptômes : la reviviscence – l’évitement – l’hyper éveil.
Le déni est présent ainsi que la déconnection de la pensée et une incapacité à ressentir les sensations, les émotions. Ce sont pourtant ces signes d’alerte pour lesquels au début la personne semble faire face.
L’évènement traumatique est constamment revécu, cauchemars, épisodes dissociatifs, flash-back, s’enchaînent dans une sorte de prison de souvenirs.
L’état émotionnel et physique changé, l’individu développe un comportement d’évitement en contournant volontairement ou involontairement tout ce qui lui rappelle de près ou de loin l’évènement traumatisant. S’installent ensuite une méfiance inhabituelle, une vigilance extrême à guetter le danger imminent, même là où il n’y en a pas.
En découlerons la plupart du temps un manque de concentration, de l’insomnie, parfois aussi une forme de dépression où la certitude d’une vie détruite prend racines et comme paralysés dans le temps, plus rien n’aura de sens aux yeux de la victime.
C’est ainsi que progressivement toute l’identité va être fragilisée.
Les conséquences d’un stress post traumatique non identifié peuvent être lourdes. Le risque de suicide est multiplié par six, mais également les diverses formes de dépendances, 80% des prises de drogues par exemple ont comme origine un SSPT. Une prise en charge psychologique rapide est fondamentale afin d’éviter les problèmes qui peuvent survenir.
Que se passe-t-il dans le cerveau?
A la suite d’un évènement traumatisant, le symptôme de reviviscence apparaît.
Le souvenir revient sans arrêt, puisqu’au niveau du cerveau il y a une hyper activité de l’hippocampe (la région produisant les souvenirs) qui active la région qui gère les émotions, l’amygdale. Malheureusement tout ceci se déroule sans faire intervenir la pensée, qui aiderait à rationnaliser.
Dès le début d’une agression, les mécanismes du stress interviennent pour permettre à l’individu de se préparer à la fuite ou au combat. L’amygdale cérébrale déclenche l’alerte face à cette situation qu’elle perçoit comme dangereuse, en produisant une décharge d’hormones (l’adrénaline et le cortisol) le flux sanguin s’accélère, les battements cardiaques et la respiration augmentent, les poumons sont en hyperventilation et les muscles contractés prêts à faire face.
Le stress est donc au départ une réaction positive du corps à un facteur extérieur perçu comme difficile et qui nécessite une adaptation.
Mais lorsque la réaction attendue, qu’elle soit celle de la fuite, de la survie, ou du combat n’est pas possible, l’atténuation de l’amygdale ne peut avoir lieu comme c’est le cas habituellement, cela donne lieu à une surchauffe.
Pendant que l’amygdale cérébrale s’affole, le cerveau lui recherche dans la banque de données des souvenirs une réponse qui puisse calmer le système d’alarme. Son but est de comprendre ce qu’il se passe et trouver une solution.
Lorsqu’aucune explication plausible n’est trouvée, l’amygdale reste active et la réponse émotionnelle à son comble maximal.
Le fait de ne pas pouvoir utiliser le surrégime de l’organisme, cause un stress dépassé et une sidération psychique. Cet état est semblable à une paralysie. La victime est figée, inerte et dans l’impossibilité de se défendre; elle est prisonnière de son propre corps.
L’adrénaline et le cortisol atteignent des taux très élevés et deviennent toxiques pour l’organisme, avec des risques vasculaire et neurologique et une impression d’être entrain de mourir. Le risque est important et c’est pour cela qu’une issue de secours est lancée.
La mort pourrait advenir si le cerveau ne libérait pas brutalement un cocktail de substances chimiques dans le but de disjoncter le système d’alarme. L’amygdale est alors isolée ! Et malgré le fait que le traumatisme se poursuive, il n’y a plus de souffrance physique, plus de souffrance psychique, c’est l’apaisement émotionnel.
Cette étrange sensation d’être spectateur d’un film, de dépersonnalisation et d’irréalité, c’est la dissociation.
Les conséquences
Ce système de sauvegarde permet de préserver la vie mais génère d’autres dégâts. L’amygdale anesthésiée par les décharges de morphine et kétamine, n’évacue pas le traumatisme vers l’hippocampe (analyse des souvenirs) le traumatisme reste piégé en l’état dans l’amygdale.
C’est une bombe à retardement prête à exploser à tout stimulus en lien avec le traumatisme subi, c’est l’élément déclencheur qui explique pourquoi certaines victimes peuvent présenter un état de stress post-traumatique des mois, voir des années après l’évènement.
C’est le cercle vicieux de la reviviscence du traumatisme qui fera adopter une stratégie de survie par l’évitement et le contrôle.
Il peut toutefois arriver que malgré ces stratégies mises en place, la mémoire du traumatisme explose, avec toute la charge émotionnelle, physique et psychique enfermées jusque là, et parce que le cercle vicieux de la reviviscence a libéré les neurotransmetteurs régulièrement, une sorte d’accoutumance s’est installée, ce qui empêchera une nouvelle disjonction spontanée du système d’alarme.
C’est alors que la quête d’une disjonction volontaire se présente comme solution à l’individu, en cherchant à s’exposer à des situations de plus en plus dangereuses et extrêmes, par exemple se mettre en danger, se blesser ou bien en utilisant drogues et l’alcool. Ainsi apparaissent les conduites dissociantes et additives pour palier de façon autonome à la survie de l’individu.
Le trouble post-traumatique peut perdurer des semaines voir des années, Il est malgré tout estimé aujourd’hui que près de la moitié des personnes souffrant de SSPT s’en remettrons spontanément dans les deux ans, en revanche les conséquences des conduites additives et dissociantes peuvent parfois rester des années ou toute une vie.
![]()
Vous êtes déjà aidé et suivi par un psychologue et/ou psychiatre et vous souhaitez aussi être accompagné pour vous sentir mieux dans votre corps, mieux dormir, diminuer l’intensité des pensées qui reviennent en boucle et retrouver une vie plus apaisée et harmonieuse ?
Je vous propose un premier entretien téléphonique de 20 minutes, gratuit, sans engagement. Nous ferons connaissance et vous pourrez m’expliquer vos attentes. Je m’engage à vous orienter vers d’autres professionnels de la santé si je pense que pratiquer la sophrologie n’est pas le mieux adapté à votre problématique.
Vous pouvez PRENDRE LE PREMIER RENDEZ-VOUS TELEPHONIQUE GRATUIT au 0631213880 ou directement via la plateforme Résalib
 Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous